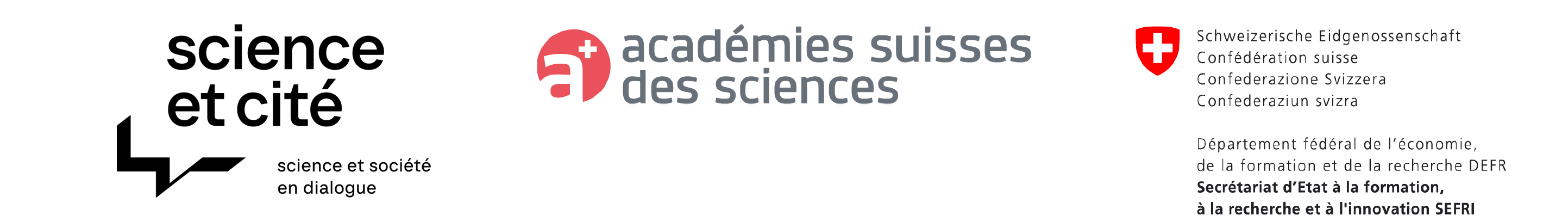Sur notre site web, nous te présentons de nombreux projets auxquels tu peux participer activement en tant que chercheuse ou chercheur.
Tu as toi-même un projet ? Alors tu peux l'inscrire gratuitement chez nous.
Tu t'intéresses à la science en Suisse et tu souhaites participer à des projets ? Alors tu es au bon endroit sur Tous scientifiques! La branche de la science à laquelle les citoyens et citoyennes peuvent participer s'appelle sciences citoyennes (Citizen Science). Tu peux en apprendre plus ici. Que tu t'intéresses aux animaux, aux plantes, aux dialectes ou à la santé, il y en a pour presque pour tous les goûts dans les projets listés.